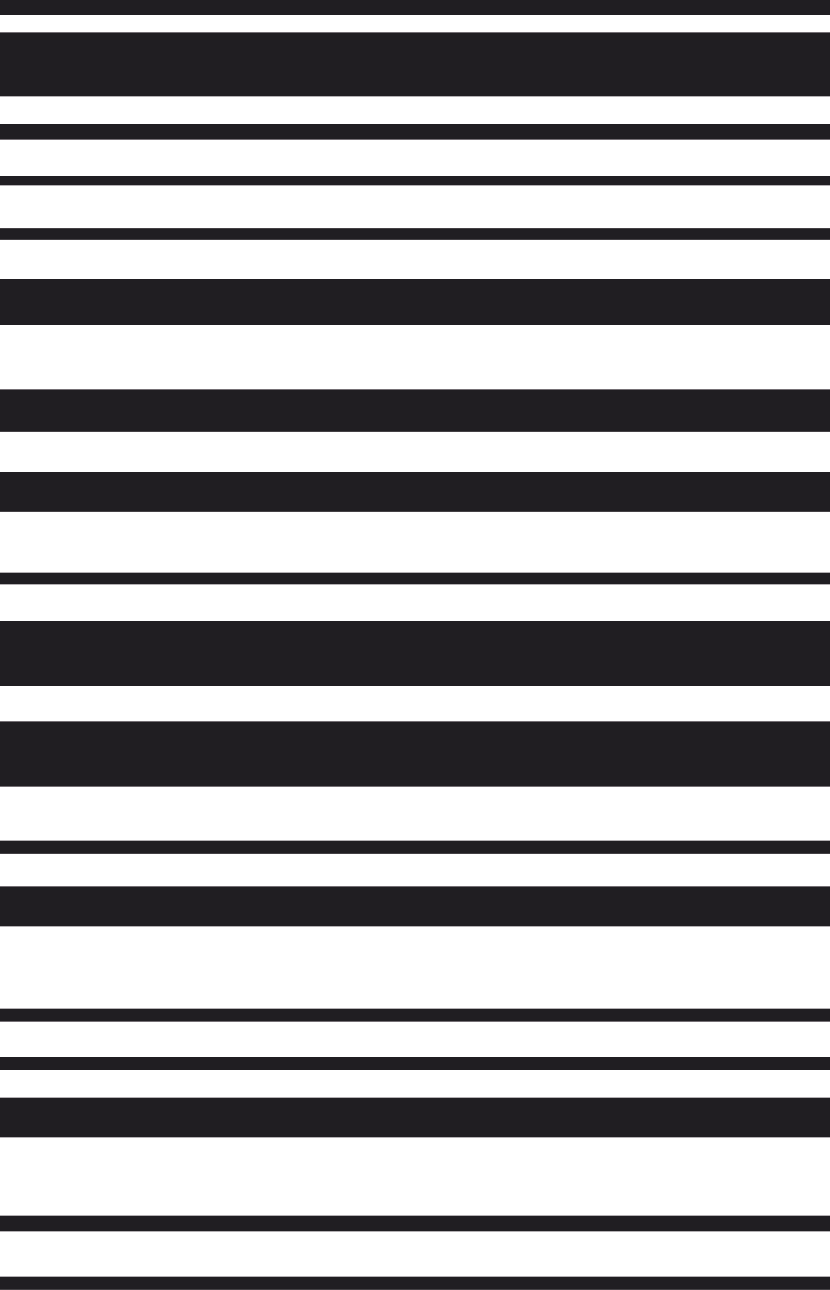En revue (T, Le Temps suisse) : “Skinny is back ?”

Le jean «skinny», très serré, est de retour! Oui, celui de Kate Moss, Hedi Slimane et Amy Winehouse, qui colle à la cuisse et entrave les chevilles. Vraiment? Pourquoi? Où? Comment? A quoi bon? Question d’époques
Commençons par une énigme comme on en posait, dans les tragédies grecques, aux héros qu’on mettait à l’épreuve. Voici la devinette: ceux qui parlent le plus de moi ne me portent pas, et ceux qui me portent ne parlent pas de moi; qui suis-je? Réponse: Le jean skinny. Le jean maigre, quoi. Soit le pantalon en denim qui moule la jambe, épouse les fesses, expose le pubis, embrasse les cuisses, étrangle les chevilles, rend la poutre apparente, cisaille la taille, menotte les enjambées et laisse sur la peau la marque de sa ceinture. Sur les réseaux sociaux (surtout TikTok), dans les magazines ou sur les podiums des défilés de mode les plus en vue, il fait son grand retour d’entre les habits morts, sortant de son enfer. En même temps, on en voit très peu dans les vitrines. Sauf qu’il n’a jamais complètement disparu des rues, porté par les jeunes commerciaux en mal de rock attitude, par les bourgeoises en stilettos et blazers ainsi que par les rockers inusables. Sans compter qu’il fait l’objet de débats pas- sionnés entre initiés. C’est bien simple, le jean skinny, ce n’est plus un pantalon, c’est le yéti à Lourdes, le point G au masculin, un mirage aux alouettes. Pour tout dire: le miroir fendillé d’une époque terriblement floue. La nôtre.
Acte de naissance. Le jean skinny (de «skin», la peau) naît dans les années 1980, quand les usines réussissent à ajouter de l’élasthanne à la toile denim. Grâce à quoi, cette dernière devient extensible et réussit à mouler le corps presque comme un collant. Avant, le jean pouvait se porter très serré, slim, mais pas au point de coller au corps – on se souvient de ces récits d’aïeux, dans les années 1970, qui enfilaient leur jean puis plongeaient tout habillés dans leur baignoire pour que leur pantalon moulât leurs jambes… Dans les eighties, le jean skinny accompagne la démocratisation des corps entraînés, musclés et cultivés qu’il révèle. Le pantalon deuxième peau est plutôt du côté de la santé, il marche vite et droit sur l’avenue de la confiance.
Mais l’âge d’or du skinny, c’est celui de son aura noire: les années 2005-2015. Les années Kate Moss et Pete Doherty, cheveux sales, jambes Q-tips, démarche titubante, jean maigre et jumeau. Les années d’Amy Winehouse aussi, pureté déchirante et déchi- rée, guiboles de héron ployant sous deux yeux trop charbonneux. La mode des mannequins squelettiques sur les podiums du luxe. L’éloge de ce que l’on a appelé le style «heroin chic» – silhouette frôlant l’anorexie, rimmel qui coule, yeux camés, mélange de vêtements précieux et de pièces grunges. Une époque où le rock tient encore le haut de la scène, et où le hip-hop n’a pas tout avalé.
Ce temps, Morgane Pouillot en parle magnifiquement – elle est cheffe de projet chez LeherpeurParis, cabinet de conseil en stratégie créative: «C’étaient les années fastes d’un certain rock, mais aussi les premières communautés internet comme MySpace ou Tumblr. La tendance «indie sleaze», indépendant négligé. Un éloge de la spontanéité, de la drogue. Pas une rébellion de classe comme celle des parents. Mais contre un mode de vie. C’est «je veux avoir de l’argent mais déborder, mener une vie dorée mais transgressive». Les figures qui incarnent ces aspirations: Cory Kennedy, les BB Brunes, les Libertines. Les marques: Gucci, American Apparel, Cheap Monday, etc. Le designer phare: Hedi Slimane chez Saint Laurent puis chez Dior. Pièce iconique: le jean skinny, inconfortable et vendu par millions de millions.


L’ESSOR DE LA “CLEAN GIRL”
Et puis le confinement et le règne sans partage du vêtement cool, du pantalon mou ou de la basket marshmallow. Et puis la montée en force d’Instagram et de ses icônes lisses et lissées, l’avènement de la «clean girl» qui porte des Birkenstock, des vêtements flottants et qui cuit son pain en battant des (faux) cils. Et puis le hip-hop dont l’uniforme baggy s’inscrit en réaction contre la maigreur du jean de rocker. Et puis – enfin! – la montée des aspirations plus inclusives et des valeurs «body positive» qui taclent l’éloge de la maigreur. Comme le dit Cyril Jordil, buyer manager pour les magasins Bongénie: «Le modèle de la «clean girl» a effacé celui de la rockeuse, la mode est passée au pantalon large en bas ou carrément oversize. Et pour celles et ceux qui cherchent à montrer leurs formes, il y a désormais le collant, associé au yoga ou à la salle de sport, bref à un style de vie plus sain.»
Bien sûr, le jean skinny a survécu dans le vestiaire de la bourgeoise en escarpins ou dans celui du kéké qui va chez le barbier et qui porte une chemise trop serrée – bref, il est passé du côté populaire et silencieux de la mode. Mais il a disparu des radars des avant- gardes. Agnès Vadi est genevoise, designer et styliste pour des personnalités en vue, elle a cofondé Abri Studio, une marque qui crée des vêtements, éclairés, urbains, parfaitement stylés. Dont des jeans qui cartonnent, très larges, très flottants. Pour rien au monde, Abri Studio ne lancerait des jeans skinny: «Le jean qui moule, c’est l’anti-inclusivité, l’éloge de la femme souvent blanche et maigre comme on en revoit de plus en plus sur les podiums. C’est un vêtement inconfortable, qui ne laisse pas libre. Et puis l’élasthanne, ça vieillit mal, ça se détend, ça ne se patine pas, ça ne s’inscrit pas dans une durée.» Même Demna Gvasalia, le designer qui a marqué la décennie à la tête de Balenciaga, lui qui n’a peur d’aucun revival discutable, se méfiait, récemment du skinny dans les colonnes du magazine Die Zeit: «We don’t want the whole world to look like sausages» («On ne veut pas que le monde entier ressemble à des saucisses»).
LE TRUMP DU VESTIAIRE
Et pourtant, le skinny est sur les podiums en vue – Miu Miu, pour ne parler que de la marque la plus prescriptrice. Sur les ré- seaux les plus influents. Même en vedette sur Zalando récemment. Comment l’expliquer? Et si le skinny, cet automne, c’était le Donald Trump du vestiaire: un truc aimé par les ploucs, détesté par un public éclairé, mais qui finit plébiscité par une élite?
Morgane Pouillot: «Cet engouement, notamment sur les réseaux, raconte une forme de nostalgie, le besoin d’aller chercher des icônes turbulentes et rock après l’obsession de la santé, du pur et du blanc. L’éloge du skinny, c’est peut-être marginal mais pas anecdotique. Porter un jean skinny sur les réseaux, c’est aller chercher dans le passé des icônes qui rassurent parce qu’elles sont connues, mais qui incarnaient une forme de transgression, d’insouciance. C’est vécu comme un contre-pouvoir où se mixent éloge de la cigarette, photos un peu cracra, goûts grinçants, allure plus aiguisée et apologie de l’Ozempic, ce médicament utilisé pour maigrir.»
On résume, on force le trait. Le jean skinny, c’est un vêtement anti-IA, en somme, un truc capable d’incarner une profondeur, des accidents, du refoulé, du toucher, de l’âpreté, de la mauvaise conscience, de la bonne foi, du déni de réalité, du rêve mal réveillé. Un jean qu’on voit partout et qui n’est jamais à sa bonne place. Un vêtement qui colle à la peau de son temps.

Par Stephan Bonvin pour T, le magazine du Temps suisse