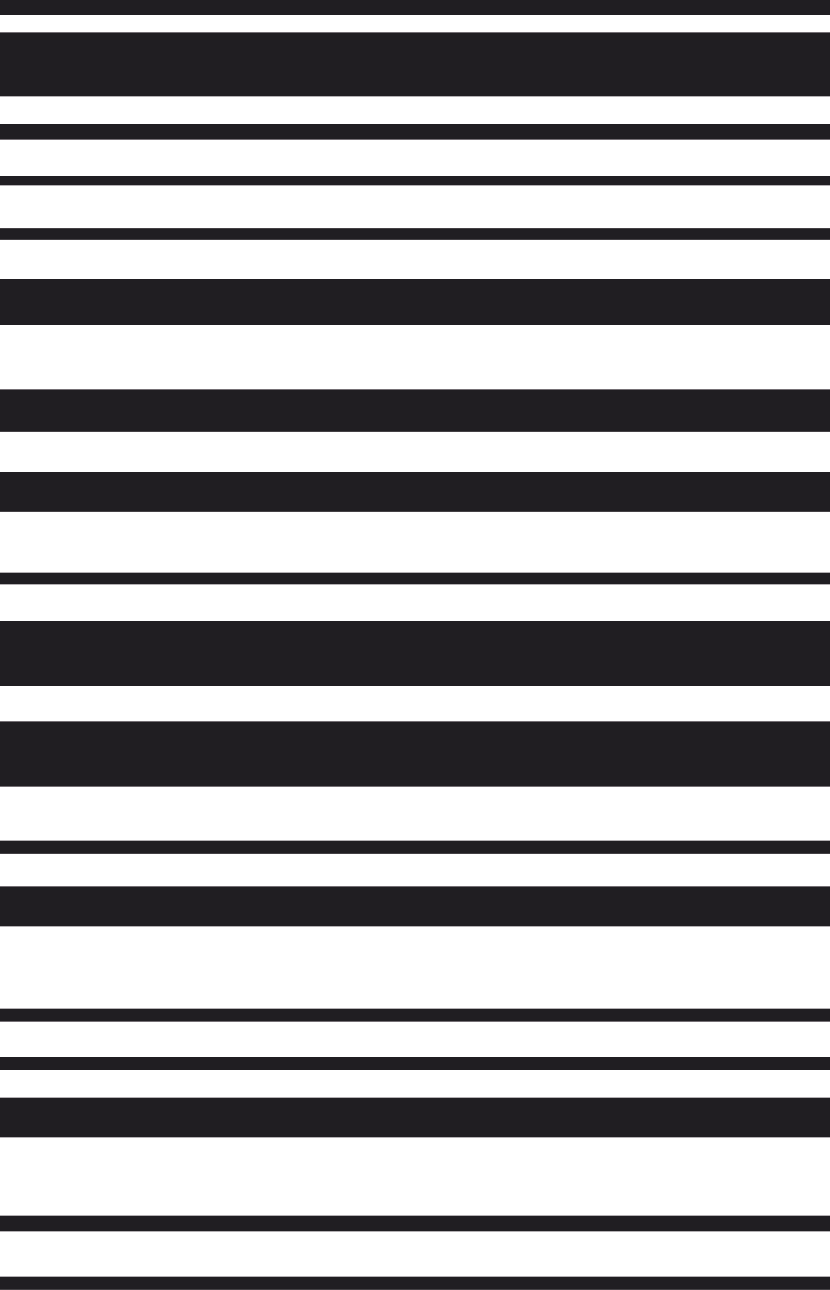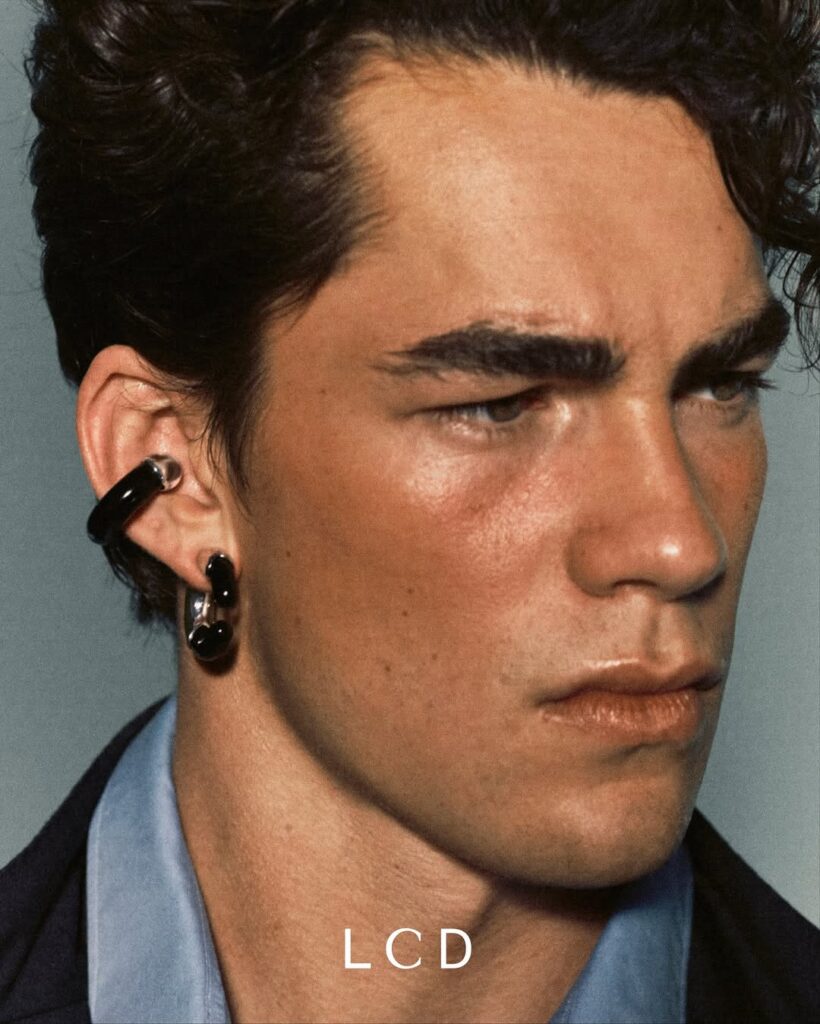En revue (L’Express) : Lux Generation – Le futur de la bijouterie-joaillerie entre ancrage et révolution

Joaillerie : “Les consommateurs de bijoux sont en recherche de repères”
Tendance. Chef de projet prospective et stratégies créatives chez LeherpeurParis, Morgane Pouillot veille sur les signes culturels et créatifs de l’air du temps.
“L’archive agit comme un ancrage”. Telle est la conviction de Morgane Pouillot, chef de projet prospective et stratégies créatives chez LeherpeurParis. De fait, nombre de maisons de joaillerie n’ont de cesse de revisiter, voire de réinventer leurs classiques. La preuve par l’Art Déco, qui s’affiche encore dans les créations contemporaines. Ce mouvement – dont Paris célèbre en ce moment le centenaire – se voulait en rupture avec le passé tout en s’inspirant du cubisme et de la culture de civilisations lointaines, ce qui ne l’avait pas empêché de poser, dès cette époque, les bases de la joaillerie moderne. Poursuivre sur la voie de l’innovation reste donc possible. A condition, comme le conseille encore Morgane Pouillot, de “redéfinir les contours de la créativité, entre héritage et révolution”.
Morgane Pouillot, qui est une chasseuse de tendances, accompagne les marques et les entreprises des industries créatives dans la construction de récits sensibles et de nouveaux imaginaires en écho aux regards et aux comportements de l’époque.
Pourquoi les marques de joaillerie réinventent-elles leurs archives ?
Dans une époque en panne de sens, noyée dans un brouhaha ambiant, les consommateurs sont en recherche de repères et d’imageries familières auxquelles se rattacher. Face à ce besoin croissant, les marques vont puiser dans leurs archives, allant de la simple réédition à l’intégration de celles-ci dans un processus dynamique de réinvention.
En renouant avec leur passé, les marques réactivent une mémoire vivante, l’archive agit comme un ancrage : elle relie à une époque, à un créateur, à un récit tout en remettant du sens, de l’attachement émotionnel dans le rapport au produit. Dans un contexte rythmé par la vitesse et l’incertitude, se tourner vers le passé devient une forme de réponse au futur incertain, une nostalgie qui agit comme une survie en allant chercher des valeurs sûres qui traversent le temps.
Cette valorisation du passé est portée par une nouvelle génération de consommateurs-collectionneurs qui privilégient des créations emblématiques et intemporelles, et font glisser l’impulsion de la consommation vers la quête d’un produit historiquement référencé, une sorte de Graal culturel.
D’où l’importance des archives…
Tout à fait. Il existe parallèlement un vrai besoin de redéfinir ce qui est précieux aujourd’hui : explorer les archives, le passé, restaurer des savoir-faire, c’est aussi un début de définition. Dans une ère du buzz où les canaux sont saturés, les archives incarnent une forme de profondeur, d’immuabilité, d’enracinement authentique, valorisant la transmission. L’héritage et le patrimoine deviennent des principes de continuité dans un monde fragmenté. Quand tout va trop vite, les archives incarnent une forme d’autorité et de permanence.
Par ailleurs, au vu des rythmes frénétiques et de la quantité de messages émis, notamment dans la création de mode, il est devenu difficile pour les designers de se concentrer et de produire un récit totalement original. Dès lors, puiser dans les archives agit comme un principe de crédibilité qui fonctionne toujours. A condition bien sûr de ne pas tomber dans des automatismes faciles, au détriment d’écritures créatives nouvelles.
Doit-on sacraliser la création ?
“Sacraliser” est un mot puissant par tout ce qu’il engage et sous-entend. Néanmoins, j’ai le sentiment que nous sommes dans une époque de vide spirituel où les récits collectifs s’effondrent. Il y a donc un réel besoin de retrouver du sens et de l’épaisseur symbolique, de la résonance. Une nécessité à explorer des territoires – la création, entre autres -, qui nous sortent du quotidien, qui remplissent ou qui, par leur capacité à ne pas toujours être connectées à la raison, nous transcendent. Dans ce contexte chaotique et quelque peu anxiogène, la création agit comme un souffle, universel non pas dans son interprétation, mais dans sa capacité à résonner intimement avec chacun, à amener ailleurs, à éblouir.
Je pense à l’exemple de la flamme la vasque olympique de Mathieu Lehanneur qui a, par sa force, sa forme créative, capté les foules, transformant le jardin des Tuileries en un lieu de pèlerinage, un espace de recueillement, semblable aux temples où se pratiquent les cultes. C’est dans l’absence d’entendement, dans ce qu’elle peut provoquer que la création se frotte au sacré. Il ne s’agit pas pour autant de la sacraliser, mais de l’ériger comme quelque chose de nécessaire, de fondamental dans ces temps de chaos. La création, comme la culture ou la beauté, n’a rien de superficiel. Bien que ce soit ce qui disparaisse vite en temps contraints, ces domaines, autant qu’ils permettent de comprendre le monde, aident à traverser les époques, à connecter les individus, à créer des espaces de légèreté, d’évasion, nécessaires à la survie.
À quoi ressemblent les nouvelles générations de consommateurs de bijoux ?
Actuellement, ils font face à un marché bruyant et saturé auquel ils imposent leurs nouveaux codes. Les nouvelles générations de consommateurs de bijoux jouent aisément des frontières pour les rendre de plus en plus poreuses, que ce soient celles du genre (le marché du bijou pour l’homme est un terreau plus que fertile, porté par de nouvelles générations qui font fi des codes), de la forme et de la fonction, du luxe et de l’accessible, du statutaire et de la fantaisie, de l’artisanat et du numérique. Ils composent un nouveau langage à la croisée de toutes les délimitations.
Ils mélangent aisément les pièces référencées et statutaires à un coût élevé avec des pièces de créateurs, plus fantaisistes, plus ludiques, qui expérimentent les formes et les matières. Ce sont aussi des utilisateurs assidus de la seconde main, devenue un réflexe. Ils sont aussi sensibles aux engagements éco-socio-responsables des marques qu’à leur capacité à être forces de propositions créatives.
Ils recherchent des propositions plus singulières, des objets de niches qui jouent avec le réel et le symbolique, comme d’Heygere, ou qui réinventent les portés, comme Lorette Coleduprat. Ils veulent des bijoux qui s’adaptent à leur usage, qu’ils peuvent détourner, réinventer — des objets qui racontent une part d’eux-mêmes tout en les reliant à une communauté.
Ils sont en recherche d’authenticité ?
Oui. Et de proximité, et d’incarnation. Ils valorisent les marques et les créateurs qui font des petites échelles et de l’imperfection des valeurs.
Ce sont des générations marquées par le pouvoir de l’image et l’ultravisibilité, où l’ “extime” a fait de l’intime un concept partagé. Cela a favorisé l’émergence de bijoux créatifs, ostentatoires, qui ne sont pas seulement des ornements, mais des signes immédiats de présence, extensions symboliques d’un style ou d’une identité, exemple du succès des bijoux de sac (charms et autre Labubu) à la croisée du bijou et de l’accessoire.
Les jeunes générations recherchent aussi un sens plus spirituel et holistique. Louis Vuitton s’est récemment engagé sur le sujet en proposant une ligne mêlant pierres et bien-être.
Le bijou n’est plus seulement apparat, il se dote d’une charge symbolique, il devient relique personnelle, support d’appartenance symbolique et matière à conversation.
Comment le design pourrait-il évoluer dans les années à venir ?
Objet de mode, objet de luxe, objet à vivre ou à porter… Que devient l’objet quand il est nécessaire de consommer moins ? On interroge beaucoup le rôle du design et de l’objet créatif dans un monde qui nous pousse à faire naturellement des choix et à gérer les priorités, en privilégiant d’abord le vital, puis l’utile.
Dans un monde où tout semble devoir avoir un sens et une fonction, le design explore de nouvelles frontières, remettant en question la fonction même de l’objet. Les tensions se jouent entre l’utilité de l’inutilité, le beau comme plaisir irrationnel, de l’apesanteur dans l’insoutenabilité. Le design d’objet futile devient une échappatoire, une réponse au besoin d’émerveillement et d’émotion.
A contrario, le design repense aussi le “less is more” radical, qui prône des créations ultra-rationnelles et adaptées à plusieurs situations, jouant sur l’ultra-optimisation et la modularité efficace. Reconnecter les sensations à la raison, ou privilégier l’un versus l’autre.
Qu’en est-il des préoccupations écologiques ?
Les questions de durabilité, d’amenuisement des ressources invitent le design à se repenser. Repenser les manières de faire, réinventer les matières premières, toutes ces notions de recyclage, d’innovations techniques, de rebuts qui deviennent le début doivent être des prérequis pour le design de demain et sont déjà incorporées dans le processus créatif des nouvelles générations de designer.
Le design de demain invite à se questionner sur ce qui a de la valeur aujourd’hui. Chaque objet pensé, fabriqué, vendu puis, acheté a un impact, mais aussi un sens : il peut être utile pour son utilisateur, valoriser un savoir-faire, être porteur d’une évolution humaine ou encore, provoquer une émotion.
Pour répondre aux nouvelles attentes, le design doit continuer de surprendre, s’inspirer des jeunes générations pour provoquer les rencontres improbables, mélanger, croiser les univers pour amplifier le résultat créatif. Je pense au succès d’une marque comme Charlotte Chesnais, à la croisée du bijou, de l’ornement, de la sculpture et de la décoration.

Il doit se nourrir des nouveaux gestes du quotidien pour mieux s’y ancrer. À la fois utilitaires, symboliques et esthétiques, on voit émerger des formes évoluées du bijou qui ornent autant qu’elles accompagnent ou racontent un mode de vie, comme les colliers-peignes chez The Row ou les colliers Gua Sha chez Lemaire. Des objets qui combinent la sensation de familiarité, le désir de polyvalence et de pragmatisme.
Quelle part pourraient occuper les outils digitaux à l’avenir et notamment l’Intelligence artificielle ?
Les outils digitaux — et l’I.A. en particulier — ne sont pas une fin en soi, mais des amplificateurs. Leur rôle n’est pas de remplacer la création humaine, mais de l’accompagner, de la projeter plus loin. Ils peuvent être de véritables supports pour embrasser ces enjeux évoqués précédemment. Le vrai défi consiste à inventer une cohabitation vertueuse entre intelligence artisanale et intelligence artificielle.
Ces technologies peuvent révéler la richesse, la profondeur, la prouesse du travail de la main. Nous sommes conscients que certains savoir-faire disparaissent plus vite qu’ils ne sont transmis et réhabilités, mais ces outils pourraient devenir des outils de préservation : enregistrer des gestes, des savoir-faire menacés, constituer une sorte de bibliothèque patrimoniale.
L’enjeu est d’éduquer, de donner les clés pour comprendre ces outils et faire envie. La peur des innovations n’est pas productive, elle tend à mettre en opposition, à diaboliser plutôt que de chercher à comprendre comment créer des ponts entre les choses et envisager comment les deux parties pourraient s’amplifier et mutuellement se nourrir pour fleurir.
De plus, ce genre d’outils permet de redonner de la valeur à ce qui était en voie d’extinction, à réhonorer ce que l’on pourrait perdre : l’humain, les productions low-tech et authentiques.
Ces outils peuvent aussi aider à sortir l’artisanat de l’image d’Épinal de Gepetto dans son atelier, et à l’ériger comme une source d’innovation, grâce à la capacité de narration permise par les outils numériques. Ils peuvent ouvrir la voie à de nouvelles esthétiques, où les codes établis s’hybrident entre patrimoine institutionnel et design moderne. Des croisements inédits qui redéfinissent les contours de la créativité, entre héritage et révolution.
Par Carine Loeillet pour L’Express